Sur Cronòpios, l’entretien vidéo (en deux parties) que nous avions réalisé à São Paulo au printemps dernier avec Solange Rebuzzi et Edson Cruz sur une invitations de Cronòpios et de Sonia Goldfeder (de la librairie Martins Fontes).

Sur Cronòpios, l’entretien vidéo (en deux parties) que nous avions réalisé à São Paulo au printemps dernier avec Solange Rebuzzi et Edson Cruz sur une invitations de Cronòpios et de Sonia Goldfeder (de la librairie Martins Fontes).


Le Travail de rivière, mon prochain livre, sort donc le 18 février chez Dissonances/Pôle graphique de la ville de Chaumont, manœuvré graphiquement par Fanette Mellier dans le cadre de sa collection : fictions (des livres bizarres).
Les fichiers sont en route vers l’imprimerie. Ce sera un objet comme un livre de contes, un excès de livre de contes, au prisme d’un cours d’eau, portant la trace de la main qui le feuillette…

Solange Rebuzzi traduit en portugais du Brésil un extrait du Bleu de l’inflexion – et j’en suis bien fière :
O joelho está flexionado a fim de dispor o corpo na vertical da fechadura.
O corpo carrega a chave mas não deseja abrir, ainda.
A mão contém a chave acariciando-a enquanto o olho se abandona à tristeza. Enquanto
o olho claro perfura, a sobrancelha contra o metal gelado, examina sem sucesso, o olho no limite de sua percepção só poderá voltar à ação. Talvez.
A mão esquerda está posta aberta, contra a madeira da porta que é uma madeira lisa.
A parede do corredor olha a cena.
O cheiro conhecido dos cabelos seduziu e murmura com o movimento da cabeça sem saber muito se e o quê e que fazer.
Com um eu-não-sei-quê de selvagem e perdido.
Com um eu-não-sei-quê de já morto.
O vestido está amarrotado de tocar o solo, levando o peso da personagem leve de coração pesado.
O vestido chia da respiração ofegante da curiosidade e do medo.
A parede do corredor se emociona.
Há carroças e móveis, bordados e espelhos.
Casas, sofás, criados, louça de ouro e de prata e de vermeil.
Ele me desejou, eu, entre todas, depois de muitas.
Eu sabia que era a boca do lobo. Lobo azul. E me lancei ali.
Eu sabia que era o medo azul do qual eu morreria. E me lancei ali.
Mas isso, só a parede do corredor escutou. Sua tapeçaria estremeceu. Uma corrente de ar de lembranças e os motivos se desdobraram. Circundam as portas. Correm de portal em portal em busca da saída. Mas o conto não existe mais pois o malvado morre e somente as mulheres se sucedem. Já que as mulheres morrem e somente os malvados se sucedem. Enquanto que as irmãs conquistam o horizonte com o olhar distraído.
Ela, vestida e penteada, ela se chama Heloisa ou Eleonora ou Isaura ou Rosalinda ou Branca ou Judite. Mas, a irmã se chama sempre Ana. A grama é verde. E a barba é sempre azul.
Tradução: Solange Rebuzzi.
Fragmento do poema retirado da revista Action poétique. n°189, p. 73.
 Et puis sur une invitation de François Bon, il s’agissait d’« écrire la ville » ou plutôt d’en parler, lundi dernier.
Et puis sur une invitation de François Bon, il s’agissait d’« écrire la ville » ou plutôt d’en parler, lundi dernier.
J’étais ravie et terrorisée. Ravie de réaliser un entretien avec François (même sur la crème au chocolat Mont Blanc ou la différence entre une perceuse à percussion et une perceuse magnétique, ça m’aurait fait plaisir) et terrorisée car, que dire sur la ville du point de vue de l’écriture ou plus exactement de mon écriture ? Elle n’est pas un personnage très présent dans mes quelques livres.
En même temps, c’était vraiment étrange de se retrouver là, au 18e étage de l’une des tours de la BNF puisque quand je suis arrivée à Paris en 1995, c’était mon paysage quotidien : je vivais au 34e étage d’une tour des Olympiades, toute proche. Et de là-haut, la ville s’étendait comme un paysage doux avec un ciel immense qui me rappelait la mer. Les orages étaient en cinémascope et on entendait les oiseaux. J’en arrivais presque à aimer Noël ; de mes hauteurs, j’adorais compter les sapins clignotants, le soir. J’aurais pu tranquillement m’adonner au voyeurisme mais cela n’a jamais été dans ma nature – hélas ! quelle matière à romans ! D’autres voisins étaient plus équipés, on devinait des télescopes tout contre les fenêtres, pas vraiment dirigés vers le ciel. Alors, j’étais modèle. Ou objet de roman. Côté chambre, on voyait le cinquième arrondissement, jusqu’à Montmartre et au-delà – mais à l’époque, je n’identifiais facilement que Montmartre, Notre-Dame, Beaubourg… J’ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi les bâtiments s’éclairaient tout à coup terriblement, successivement – les péniches ! Le chat, quant à lui, n’a jamais compris d’où il pouvait bien voir des êtres humains de la taille de fourmis. Il est vite retourné dans ses zones méditerranéennes avant de sombrer en dépression. En se penchant de la fenêtre de la chambre et en regardant en direction de la tour Helsinki (la tour de luxe aux appartements cinq pièces), on pouvait voir la Tour Eiffel mais on n’aimait guère que je me penche. Pourtant, j’ai toujours aimé regarder la Tour Eiffel. Côté salon et cuisine, c’était le XIIIe asiatique (Tang Frères en à-pic) et la banlieue, avec cette cheminée crachant en permanence une fumée blanche. Après avoir regardé pendant trois ans cette zone « Très Grande Bibliothèque » en construction, voilà qu’à présent, je cherchais la fenêtre de mon ancien appartement en ayant à parler de la ville avec laquelle j’entretiens des rapports ambivalents. À Bastia, je me définissais radicalement comme citadine – ou plutôt bastiaise, ce qui là-bas veut tout dire (une ajaccienne n’étant pas une bastiaise). J’aimais la plage, qui n’exclut pas la ville, mais la campagne m’emmerdait copieusement, rien de pire que ces interminables balades dans le maquis, la castagniccia. Je finissais toujours par me paumer et appeler mon père au secours en me retrouvant nez-à-nez avec une laie rose et noire au grognement vindicatif. En plus, je détestais l’odeur des séchoir à châtaignes qui imprégnait les cheveux et la soupe paysanne au goût très prononcé à finir absolument si on voulait espérer se lever de table ; étant astigmate, j’étais très mauvaise ramasseuse de champignons, il n’y avait guère que les oronges que je repérais à peu près – un œuf à la coque surgissant entre des feuilles de châtaigniers, ça se remarque – et comme il n’y en avait pas tant que ça… Bref, citadine. Et à présent, après 2008 – 1995 = oula, déjà 13 ans à Paris, je sature un peu de l’urbanité capitale quotidienne. J’aime Paris parce que c’est beau Paris. J’aime Paris parce que dans le quartier où j’habite, je me sens en Afrique et que c’est très agréable – le patron de café qui me sert chaleureusement la main, les passants du marché Château Rouge qui se précipitent pour m’aider à ramasser mes fruits échappés d’un sac en plastic éventré… – pourvu que ça dure en ces temps obscures de sarkozysme. J’aime Paris parce que ben depuis 13 ans, j’y ai la quasi totalité de mes amis. J’aime Paris parce qu’il s’y passe beaucoup de choses artistiques. Mais le bruit permanent, les parisiens (vous savez, ceux qu’ « il vaut mieux avoir en journal »), la pollution qui me met le cuir chevelu en sang 360 jours sur 365, le temps pourri (parisien, c’est un synonyme), le coût de la vie (5 euros – ça fait quand même dans les 32 francs, je mangeais bien, pour ce prix-là, en 1995 – une pauv’ binouse de fin de cuve, ah ! ah ! ah !), la foule permanente, l’attente permanente, l’impolitesse permanente, l’absence de citoyenneté permanente… Bref, j’aime Paris comme après 13 ans de mariage. J’aurais du mal à m’en passer mais je ne survis qu’en lui faisant des infidélités de temps à autres.
Évidemment, on s’en doute, l’entretien n’a pas porté uniquement sur la ville. Beaucoup sur le processus d’écriture. Et j’aime toujours ce genre de moment unique qui permet de formuler des choses qu’on n’avait jamais formulées ainsi auparavant. C’est un cadeau inestimable.
J’aurais bien aimé être petite souris ou mulot, tiens – remarquez, dans une tour de la Très Grande Bibliothèque, mon espérance de vie aurait sans doute été très courte – pour pouvoir assister à tous les autres entretiens. Mais j’étais détendue comme un lundi avec des documents Excell à remplir pour notre diffuseur – ce qui me fait à peu près le même effet capillaire que la pollution.
Photo : François Bon.
Tagué:écrire la ville, BNF, François Bon, Laure Limongi
Un état du début de mon texte sur Twin Peaks pour Écrivains en séries…
 Welcome to Twin Peaks. My name is Margaret Lanterman. I live in Twin Peaks. I am known as the Log Lady. There is a story behind that. There are many stories in Twin Peaks – some of them are sad, some funny. Some of them are stories of madness, of violence. Some are ordinary. Yet they all have about them a sense of mystery – the mystery of life. Sometimes, the mystery of death. The mystery of the woods. The woods surrounding Twin Peaks.
Welcome to Twin Peaks. My name is Margaret Lanterman. I live in Twin Peaks. I am known as the Log Lady. There is a story behind that. There are many stories in Twin Peaks – some of them are sad, some funny. Some of them are stories of madness, of violence. Some are ordinary. Yet they all have about them a sense of mystery – the mystery of life. Sometimes, the mystery of death. The mystery of the woods. The woods surrounding Twin Peaks.
To introduce this story, let me just say it encompasses the all – it is beyond the fire, though few would know that meaning. It is a story of many, but begins with one – and I knew her.
The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one.
L’envers du décor
Les ombres de la forêt
La nuit sert à entendre et le jour à voir
Laura Palmer ne se résoud pas à mourir
Sometime ideas, like men, jump up and say « hello ». They introduce themselves, these ideas, with words. Are they words ? These ideas speak so strangely. All that we see in this world is based on someone’s ideas. Some ideas are destructive, some are constructive. Some ideas can arrive in the form of a dream. I can say it again : some ideas arrive in the form of a dream.
En gesticulant. Scènes de désespoir, de lamentations. La mère, masque de tragédienne, est sous calmant, prostrée au fond d’un canapé. La télévision est allumée. Le père oublie toute dignité, sanglote en public, pantin manipulé par la violence de la douleur. Leur espoir, leur enfant devenue grande, trop vite. Arrachée à la vie. La petite ville de Twin Peaks est stupéfiée. Le charme de sa nature grandiose, rompu. Comment une telle chose peut-être arriver dans un endroit aussi paisible ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? En gesticulant, en pleurant, on s’interroge. Il était une fois la mort de la belle Laura Palmer. Le 23 février 1989. Laura, la belle Laura, fierté de tous, retrouvée morte, flottant sur une rivière dans une aube glacée, près de l’usine de bois. La rumeur laisse passer. Des gémissements, quelques doutes. J’étais déjà partie. Les cheveux blonds, trempés, ondulés, la pâleur du visage ceint d’un drapé opaque de plastique immaculé lui donnent l’aura d’un ange lassé, malgré lui. C’était écrit, d’ailleurs.
There is a sadness in this world, for we are ignorant of many things. Yes, we are ignorant of many beautiful things – things like the truth. So sadness, in our ignorance, is very real.
The tears are real. What is this thing called a tear ? There are even tiny ducts–tear ducts – to produce these tears should the sadness occur. Then the day when the sadness comes – then we ask : « Will this sadness which makes me cry – will this sadness that makes my heart cry out – will it ever end ? »
The answer, of course, is yes. One day the sadness will end.
Il y a toujours de la musique dans l’air. Mis en scène par l’encadrement de la fenêtre, le spectacle de la famille déchirée de douleur. On ne distingue que des hoquets entrecoupés de mots d’amour à l’attention de leur petite fille morte, leur enfant si lumineuse. Et le contraste de la campagne alentour, d’un vert tonitruant. Elle pourrait en raconter tant, de jour comme de nuit. Et moi donc. La cime des grands arbres ondule une chanson triste. Les chœurs sont des jeunes filles éplorées, intemporelles. Sans conviction, les élèves du lycée de Twin Peaks poursuivent leur journée de cours après la macabre nouvelle. Mais l’entourage proche de Laura ne parvient pas à surmonter le choc. « Que faire dans un monde où n’importe qui peut surgir de n’importe où et faire n’importe quoi ? » Personne ne comprend comment le conte de fées a pu ainsi tourner au cauchemar, comment la jolie princesse blonde au sourire renversant a pu être sacrifiée avec tant de violence. Un déchaînement qui paraît inhumain, comme le fruit de forces obscures et lointaines. Dans cette petite ville noyée au cœur de la forêt, plus qu’ailleurs, on connaît le poids d’une histoire tissée de légendes indiennes, le combat permanent du bien et du mal au cœur de chaque instant. (Le poids de l’histoire et des légendes, et ce qu’il en coûte de ne pas écouter les menaces grandiloquentes du vent dans les sycomores.)
…


Le Circus de Fanette Mellier à Chaumont. Déambulation graphique à partir de ce texte, que j’ai écrit pour l’occasion :
entre chien et loup
les arbres
suaires
si
sereins au vent
crient le jour après
la nuit claire indécise

Dix neuvième festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont (faudrait mettre plus de cap’, F, I, A, G…) J’avais oublié les villes où le temps passe lentement (c’est un compliment). C’est bon de voir des bords de route avec des ronces, du chiendent, des crottes de renard, de la ciguë. La liberté des friches me manque. Mais le vide de rues des petites villes de province entre midi de deux heures – façon explosion nucléaire, je suis la dernière personne sur terre – m’angoisse. Je n’aurais pas dû mettre des bottines à talons alors qu’on marche en moyenne cinq kilomètres par jour à Chaumont (vœu pieux pour un prochain festival).
Très éclairante présentation du remarquable site poptronics (Annick Rivoire/Christophe Jacquet), que j’avais un peu perdu de vue depuis son lancement – shame on me, je vais me rattraper. Super concert Rolax au Super. Beau Bastard Battle version graphique. Affiches affichées. Et je connais peu de monde dans le graphisme, c’était presque des vacances, je n’ai croisé aucun fâcheux. Tout va bien.
Lu à Chaumont – affiches off, je crois : « Graphiste fucking », « Casper le petit Pantone », « I Shot The Serif » (spéciale dédicace à Thomas Lélu). Et entre la gare et les Subsistances : « France mélasses » (c’est une usine).
Je suis très fière de mon texte pour Fanette, disséminé dans la ville = de la réalisation graphique de Fanette (j’en mettrai ici les photos en diaporama dès que je les aurai reçues). En voici, déjà, le texte :
entre chien et loup
les arbres
suaires
si
sereins au vent
crient le jour après
la nuit claire indécise
Pas mécontente non plus de ma lecture à l’Autoharp. Confession : je n’avais jusqu’à présent jamais été vraiment à l’aise lors de mes « performances » : lecture + montage sonore réalisé sur ordinateur et/ou diaporama. J’ai l’impression que l’interface numérique dans ce contexte-là me bride, comme une barrière entre moi et moi. Entre le public et moi. Mais c’est sans doute une question d’apprivoisement. Ou de nature. L’avenir me le dira – la main sur la bibliothèque de bois. Jusqu’à présent, ces tentatives performatives me semblaient ratées. Enfin bof, quoi. Refaire de la musique m’a fait du bien. Je crois que je commence à entrevoir un « dispositif » (pour employer de grands mots) qui me correspond. Dans lequel je suis bien. Je regarde l’heure mais je ne la vois pas. Alors, je ne cesse d’ouvrir mon téléphone portable bivalve pour la consulter, façon TOC. J’ai un train à prendre.
(Image : affiche de Mathias Schweizer pour le festival de Chaumont, 2007).
* Addenda : fragment de copie, recto-verso, déchirée, trouvée dans un buisson à Chaumont :
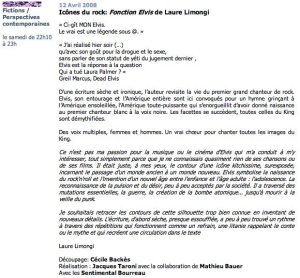
Samedi 12 avril, 22h10, sur France Culture : fictions / perspectives contemporaines.
Dans la série « icônes du rock » :
Découpage : Cécile Backès
Réalisation : Jacques Taroni avec la collaboration de Mathieu Bauer
Avec les Sentimental Bourreau

Ne manquez pas le Libé des écrivains de ce jour, m’est avis, un sacré collector.
Pour ma part, j’y ai coordonné le Contre Journal (rubrique de Karl Laske, l’article paraîtra sur deux jours) et écrit quelques autres papiers… notamment en sport (hé oui !) et en économie (hé oui !). Non sans une certains angoisse de se confronter à des matières si distantes en un temps si court (pas le temps de se faire une crise de pourquoi et dans quel état erre-je ?), et avec un nombre de signes limités ! (pas l’espace de la digression, ou, ne se concentrer que sur ce qui digresse, strictement) mais c’est la règle du jeu. Et ma foi, elle est sacrément passionnante.
Une vraie ambiance de colonie de vacances, des échanges uniques, des rencontres, une journée qui est passée trop vite… merci Libé !

Je l’ai déjà évoqué, le RALBUM ROUGE est un projet créé par Emmanuel Tugny & Olivier Mellano qui paraît (livre + disque) en mai et dont vous pouvez déjà entendre des extraits ici.
L’idée, épidermique, face à une situation politique et sociale qu’il est inutile de détailler, était de solliciter auprès d’écrivains que nous apprécions un texte de chanson, tout aussi épidermique et motivé. D’où le « président nucléaire » d’Éric Meunié, le « Nisard » à détruire de Chevillard, le « carré de haine sur fond rouge » de Nathalie Talec, le « crève » d’Emmanuel Tugny, la « chute » inexorable d’Olivier Mellano, le « bon papa » de Nathalie Quintane, etc.
Mon texte, quant à lui, s’appelle « ouvriers vivants ». Le titre est une référence explicite à un livre éponyme publié aux Éditions Al Dante en 1999, un des premiers auquel j’ai travaillé, éditorialement, chez Al Dante (principalement en constituant un matériel photographique) et qui a été une forte expérience politique et esthétique. Un livre collectif dont l’énergie était assez proche de celle du RALBUM ROUGE, avec des textes de Philippe Beck, Jean-Marie Gleize, Josée Lapeyrère, La Rédaction, Vannina Maestri, Natasha Michel, Katy Molnar, Charles Pennequin, Christophe Tarkos. Je me souviens du sourire radieux de Josée pendant les manifestations, de la parole limpide et lumineuse des ouvriers, inventant une langue pour exister, du quatrième de couverture retravaillé chez Jacques-Henri Michot, avec Laurent Cauwet, à Mouchin, de la force acérée de chacun des textes de ce livre… J’espère y faire écho et contribuer à enfoncer le clou de cette lutte plus que jamais d’actualité.
La musique de cette chanson est d’Olivier Mellano. La deuxième voix de Benoît Burello, les voix wyattiennes sont d’Emmanuel Tugny & Benoît Burello.

Tagué:Al Dante, Laure Limongi, ouvriers vivants